Conférence du professeur Pierre-François Peirano, dans le cadre du séminaire de recherche de l’équipe « Monde anglophone contemporain » : « Apogée et déclin du Western dans les Etats-Unis contemporains »
Lundi 12 février à 17h30 en salle W’115.

Conférence du professeur Pierre-François Peirano, dans le cadre du séminaire de recherche de l’équipe « Monde anglophone contemporain » : « Apogée et déclin du Western dans les Etats-Unis contemporains »
Lundi 12 février à 17h30 en salle W’115.

En lien avec l’axe identitaire de l’université, « Echanges et Sociétés Méditerranéennes », le thème « Itinérances des textes » – inspiré par ceux de récents colloques co-organisés par Babel (« Itinérances spirituelles » et « Itinérances maritimes en Méditerranée ») – engage à étudier la circulation des livres en tant qu’objets ainsi que la diffusion et la réception des idées transmises par ces livres.
Généralités théoriques
La circulation des textes et des idées, sous diverses formes et divers supports, a dressé des passerelles entre les différentes aires culturelles établies autour de la Méditerranée, ce mouvement pouvant s’étendre, au sens large et dans une perspective envisageant les déplacements de proche en proche, aux Îles britanniques, à l’Europe du Nord et orientale, au Moyen orient, à l’Afrique sub-saharienne…
Le propos de ce séminaire consiste à se pencher sur les critères qui, à l’origine du déplacement ainsi qu’à son aboutissement, motivent de telles entreprises, qu’elles soient promues par des initiatives individuelles ponctuellement limitées dans le temps ou par des phénomènes collectifs à plus long terme.
Dans cette perspective, les participants seront invités à s’interroger sur les raisons qui conduisent à distinguer tel livre ou tel texte pour le diffuser auprès d’un lectorat auquel il n’était pas destiné à l’origine, ainsi que sur les modalités et les conditions de sa réception auprès de ce public, différent par la culture, la génération et la langue, du public premier.
En lien avec le déplacement dans le temps et l’espace[1], ces études peuvent également se pencher sur les mutations qui affectent ces livres et ces textes déplacés : transferts entre divers supports, translation d’une langue à une autre, réécritures ou adaptations…
Domaines possibles d’étude
À titre d’exemple, dans une première approche intuitive et sans prétention à l’exhaustivité, il est possible d’indexer quelques domaines et étapes à l’ensemble de ces questions, comme :
Au XIXe siècle, avec le développement de la presse, de l’édition et du lectorat de masse, le phénomène se précipite. Ainsi, les grands débats européens autour de l’expansion coloniale, du darwinisme, du positivisme et de l’idéalisme… s’élaborent dans un contexte d’échanges globaux qui intègrent le Sud de la Méditerranée et le Nouveau monde, ce dernier lisant souvent la réalité autochtone à la lumière des idées transmises par les œuvres de Schopenhauer, Spencer, Renan… tandis que le premier sert de décors orientaliste à la mise en scène des relations entre l’Autre et l’Occident.
Enfin, d’autres phénomènes encore plus récents méritent d’être considérés, tels que le succès des littératures franco-maghrébines en France, la conservation et le déplacement – par souci de préservation – des manuscrits tombouctiens ou syriaques, l’hybridation des supports liée à la transmédialité, la numérisation des textes et les nouveaux modes de diffusion numérique…
Mots-clés susceptibles d’apparaître dans les propositions, à relier toujours aux notions d’itinérance et de diffusion :
Organisation
Ce programme peut guider les travaux de l’équipe « Texte et livre » pendant deux ans. Il devra conduire à l’organisation d’un séminaire, sous forme de conférences ou de journées, à déterminer selon le nombre et la nature des propositions reçues.
Les collègues sont invités à diffuser cette circulaire auprès des chercheurs extérieurs susceptibles d’être intéressées par ce séminaire.
Toute personne souhaitant intervenir pourra envoyer sa proposition (titre, résumé d’une vingtaine de lignes, court CV si la personne n’est pas rattachée au Laboratoire Babel) au plus tard le vendredi 22 décembre 2017, à xavier.leroux@univ-tln.fr et/ou à jose.garcia-romeu@univ-tln.fr.
Dès qu’un nombre conséquent de propositions aura été recueilli, l’équipe « Texte et livre » se réunira pour les sélectionner, si nécessaire, et pour établir un calendrier des journées ou des conférences.
[1] Nous considérons la dimension spatiale comme décisive, car elle permettra de centrer les études sur des phénomènes plus précis que ceux couverts par le champ immense des transtextualités, transpositions et transformations diverses exposées par Genette dans Palimpseste.

Conférence de Laura Alcoba le Mardi 27 Février 2018 en salle Y013a à 17h.
Dans le cadre des Conférences grand public 2017-2018 organisées à l’UFR Lettres de l’Université de Toulon, le Laboratoire Babel a le plaisir de recevoir la romancière franco-argentine Laura Alcoba.
On doit à cette écrivaine un subtil travail de mémoire qui a débouché, entre autres, sur une trilogie publiée entre 2007 et 2017 où elle recueille ses expériences d’enfant confrontée à la répression politique et à l’exil, en Argentine et en France (Manèges, Le Bleu des abeilles, La Danse de l’araignée). Elle a prolongé cette exploration en plongeant, au-delà de ses souvenirs personnels, dans la mémoire collective de son pays d’origine, que ce soit en reconstituant un épisode significatif de la vie de ses parents – engagés comme nombre de compagnons dans un idéal révolutionnaire exclusif (Les Passagers de l’Anna C., 2011) – ou en invoquant les figures d’Eva et de Juan Domingo Perón, croisées avec humour à celle d’Ava Gardner (Jardin blanc, 2009).
Guidée par la recherche des racines et l’examen mémoriel, l’œuvre de Laura Alcoba est particulièrement représentative d’une génération frappée, dès l’enfance, par une réalité historique brutale qui ne cesse de hanter l’Argentine, quarante ans après les faits. Grâce à sa retenue et à son humour, elle parvient à désarmer les effets pathologiques de cette hantise et offre une prose apaisée et lumineuse. Elle mérite à ce titre toute la considération des lecteurs.
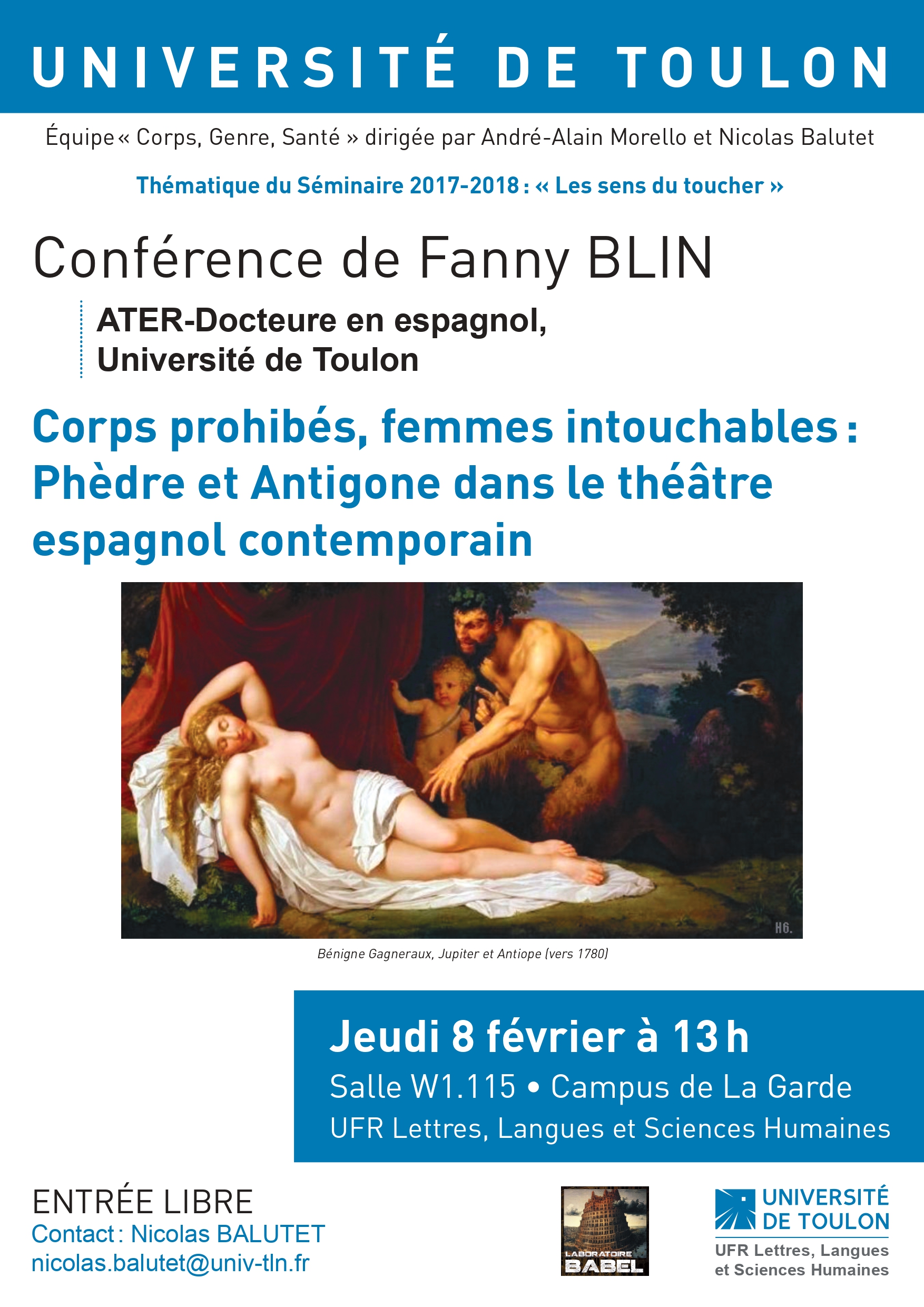
Jeudi 8 février à 13h en salle W1.115
Conférence animée par Fanny Blin, ATER-Docteure en espagnol : « Corps prohibés, femmes intouchables: Phèdre et Antigone dans le théâtre espagnol contemporain«
Contact: nicolas.balutet@univ-tln.fr
Équipe« Corps, Genre, Santé » dirigée par André-Alain Morello et Nicolas Balutet.
ENTRÉE LIBRE
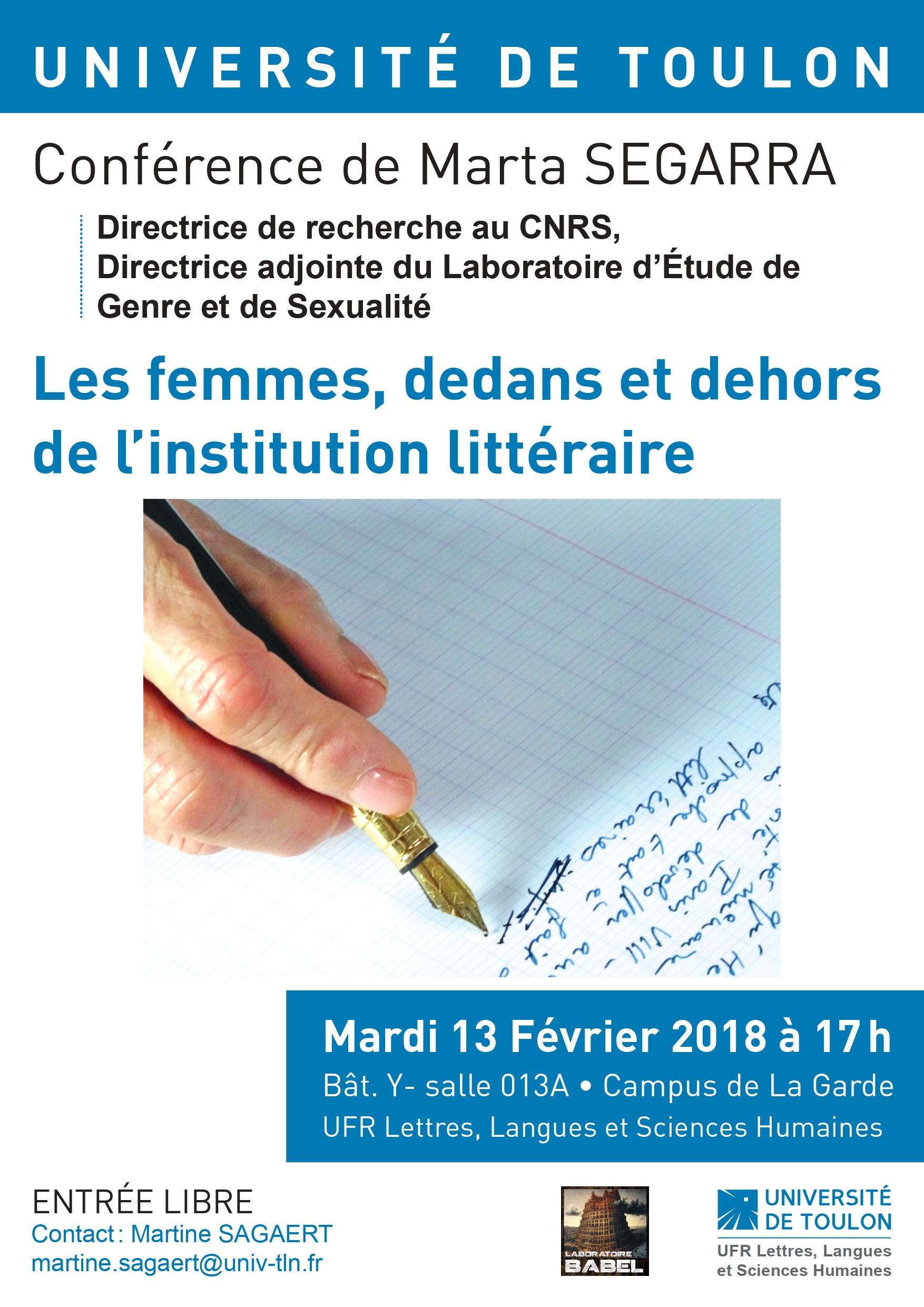
Conférence de Marta SEGARRA, directrice de recherche CNRS et membre du Laboratoire d’Étude de Genre et de Sexualité. Directrice adjointe du LEGS.
Malgré leur activité incontestable dans l’institution et la pratique littéraires, les femmes ont moins de place que les hommes dans la mémoire littéraire ; les manuels d’histoire de la littérature française publiés en France comme les programmes scolaires et les programmes des concours en témoignent. Si, à d’autres époques, la place plus restreinte accordée aux femmes dans la vie littéraire semble s’expliquer par les inégalités sociales et symboliques dues au genre, le fait que les auteures occupent, encore au XXe siècle, une position secondaire dans la « République des lettres » française laisse penser qu’il y a d’autres facteurs qui les écartent de la « place publique » de la culture (des maisons d’édition les plus prestigieuses comme des revues littéraires, qui ont eu un rôle si puissant dans la vie littéraire du XXe siècle) ainsi que du « Panthéon » littéraire (dont les mécanismes de consécration, tels que l’obtention de certains prix littéraires, d’un siège à l’Académie ou de la publication dans certaines collections ont tendu à exclure les écrivaines, du moins jusqu’à la fin du deuxième millénaire).

Populism is traditionally considered as a vague and elusive concept, its heterogeneity making it difficult to define. The main common denominator of populist parties is to oppose the people to the elite, perceived as two homogeneous and antagonistic groups (Mudde, 2004). The populist discourse offers a dualist view of the world, and is characterized by an appeal to the people, “inevitably mythical, ideal or imaginary » (Reynié, 2013), and which Taggart refers to as the « heartland”.
Although populism first appeared in the 19th century in Russia, France and the United States, this conference focuses on the contemporary populist phenomenon which has emerged in Europe in the early 1990s.
Recent events suggest that the populist temptation within the electorate has significantly increased, as shown in France by the qualification of the Front National for the second round of the presidential election, and the historic score achieved by the party. Marine Le Pen had presented this election as the third act of the “awakening of the people”, following the surprise victory of the Brexit vote in the 23 June 2016 referendum and the equally unexpected election of Donald Trump as US president on 8 November 2016. Throughout Europe, populist parties have gained ground in countries such as Italy, The Netherlands, Austria, Hungary, the UK, Denmark … Although Emmanuel Macron’s victory, coming after the first populists’ setbacks in Austria and the Netherlands, appeared to put a halt to what looks like a new populist wave, it is important to remain cautious.
Should this be regarded as a coincidence or as a global phenomenon? This conference aims at exploring this new populist wave, trying to identify the common points, as well as the differences, between its various manifestations. What are the similarities between left-wing and right-wing populism?
This populist contagion also applies to traditional political parties, some of which might be tempted to adopt a populist rhetoric: by what means and with what results ? More generally, how do these parties address the populist threat?
Topics may include, but are not limited to, the following:

14 et 15 Juin 2018.
Le populisme est traditionnellement considéré comme un concept vague et mouvant, dont la dimension hétérogène semble compliquer toute tentative de caractérisation. Le principal dénominateur commun des partis populistes est d’opposer le peuple aux élites, perçus comme deux groupes homogènes et antagonistes (Mudde, 2004). Le discours populiste propose une vision dualiste du monde, et se caractérise par un appel au peuple, « inévitablement un peuple mythique, idéal ou imaginaire » (Reynié, 2013) que Taggart désigne aussi sous le terme de ‘‘heartland’’.
Si les premières manifestations du populisme remontent au XIXe siècle et se situent aussi bien en Russie qu’en France et aux Etats-Unis, ce colloque se concentre sur le phénomène populiste contemporain qui a émergé en Europe à partir du début des années 1990.
L’actualité récente semble indiquer que la tentation populiste au sein de l’électorat s’est sensiblement amplifiée, une tendance illustrée en France par la présence du Front National au second tour de l’élection présidentielle, et le score historique remporté par le parti. Marine Le Pen avait présenté cette élection comme le troisième acte du « réveil des peuples », après la victoire surprise du Brexit lors du référendum du 23 juin 2016 et l’élection non moins inattendue de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis le 8 novembre 2016. Partout en Europe, les partis populistes ont gagné du terrain : Italie, Pays-Bas, Autriche, Hongrie, Royaume-Uni, Danemark … Si la victoire d’Emmanuel Macron, intervenue après les revers des populistes en Autriche et aux Pays-Bas, a semblé marquer un coup d’arrêt à ce qui ressemble fort à une nouvelle vague populiste, la prudence reste de mise.
S’agit-il d’une coïncidence ou d’un phénomène global ? L’objectif de ce colloque est de se pencher sur cette nouvelle vague populiste en essayant d’identifier les points communs, mais aussi les différences, entre ses différentes manifestations. Quoi de commun entre populisme de gauche et populisme de droite?
La contagion populiste qui fait l’objet de ce colloque s’applique également aux partis politiques traditionnels, dont certains peuvent parfois être tentés par l’adoption d’un discours populiste : par quels mécanismes et avec quels résultats ? Plus globalement, de quelle manière ces partis s’efforcent-ils de contrer la menace populiste ?
Les aspects suivants pourront être analysés (liste non exhaustive):
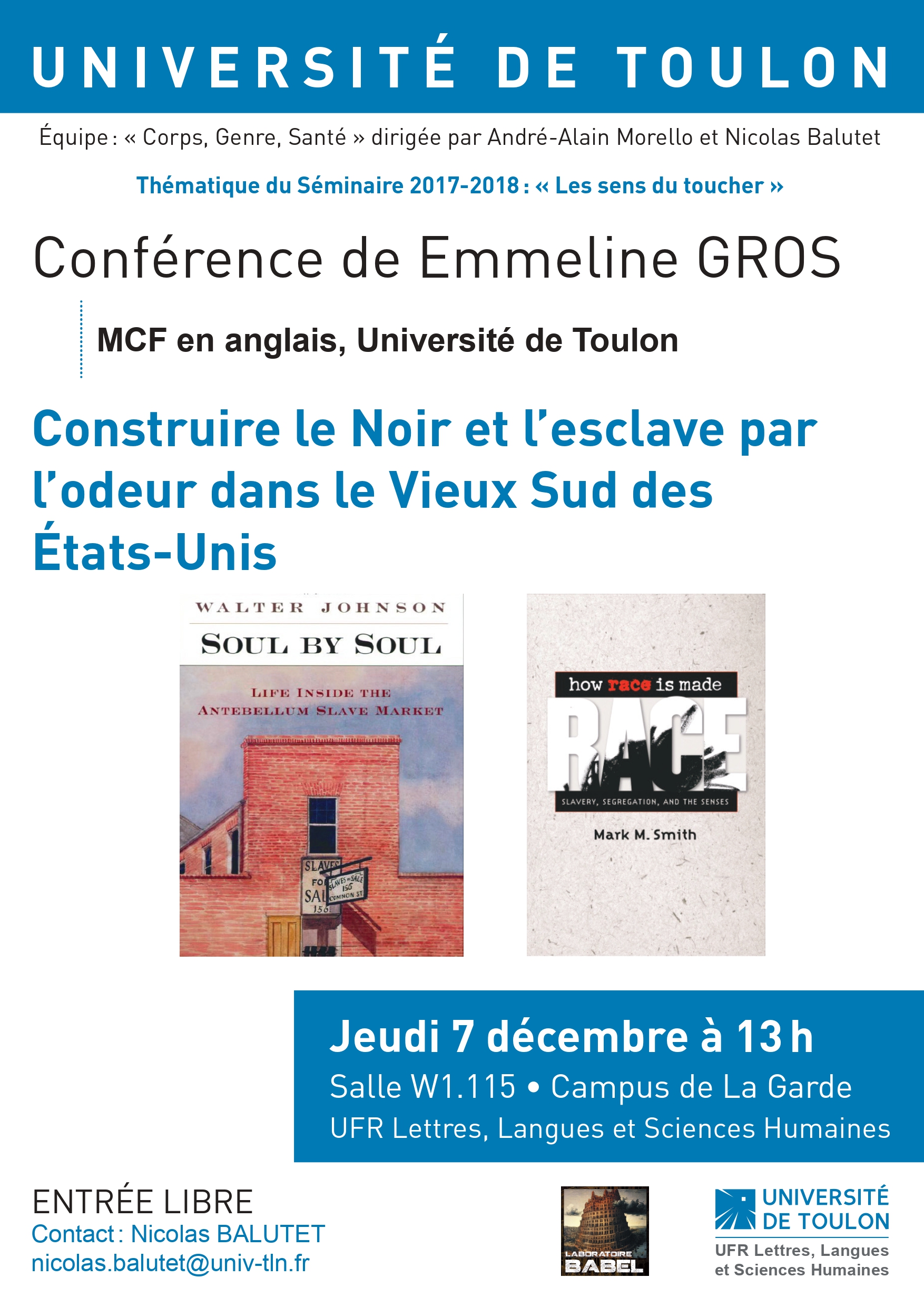
Conférence animée par Emmeline Gros, MCF en anglais à l’Université de Toulon : « Construire le Noir et l’esclave par l’odeur dans le Vieux Sud des États-Unis«
Jeudi 7 décembre à 13h en salle W1.115.
Contact: nicolas.balutet@univ-tln.fr
ENTRÉE LIBRE
Équipe: « Corps, Genre, Santé » dirigée par André-Alain Morello et Nicolas Balutet

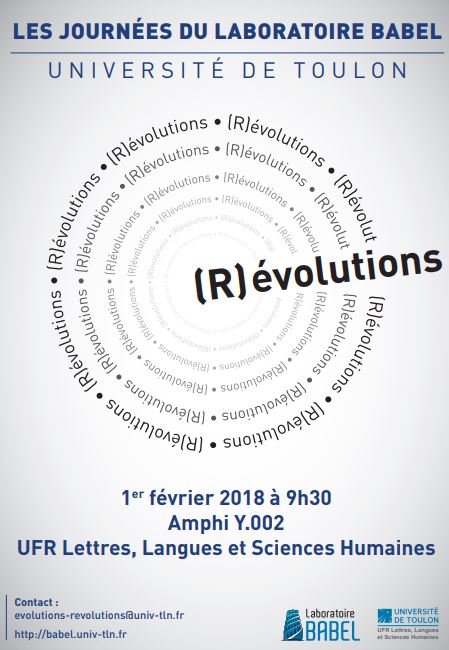
The Arab Spring has provided space for previously marginalized female activism to participate in democratic processes, which has created a shift in feminist politics. Female Islamist activists have particularly gained legitimacy in the context of the Arab Spring which has brought the Justice and Development conservative political party into power. This has contributed to a movement from an elite liberal state feminism to a more legitimate religious activism. This has also introduced new spaces for contention, such as the emerging nuanced female political and civic expression(s). That said, the visibility of religiously-inspired female activism was shortly subjected to discursive othering and marginalization through the construction of a state-sanctioned Islamic feminist discourse. This paper therefore seeks to explore the broader political implications of the disputed label ‘Islamic feminism’ in the context of the state’s co-optation and marginalization processes. I argue that the systemic marginalization religisouly-inspired social agents shrinks down the public space and undermines the ‘woman question’ and the expanded possibilities for women’s socio-political empowerment. Therefore, although the Moroccan religious sphere is pluralistic to a significant extent, it is also deeply centralized and institutionalized. Morocco comprises competing interpretations of Islam, the authority of which is determined by what the state favors as more ‘legitimate’. One can therefore deduce that the state’s hegemonic structures though can be conducive but mostly impeding to religiously-inspired activism with its different strands (state-based and non-state). These movements navigate the tension between conformity and opposition to existing structures, while they occasionally maneuver to expand political spaces by creating alternative structures. That said, it is within the negotiation of the dynamics of opposition and co-optation that female religiously inspired movements or expressions have the potential of re-framing new social demands, and constructing new approaches to political participation to problematize and redefine the ‘mainstream’ as well as developing narratives and mechanisms to naturalize their visibility and mobility in the public space.